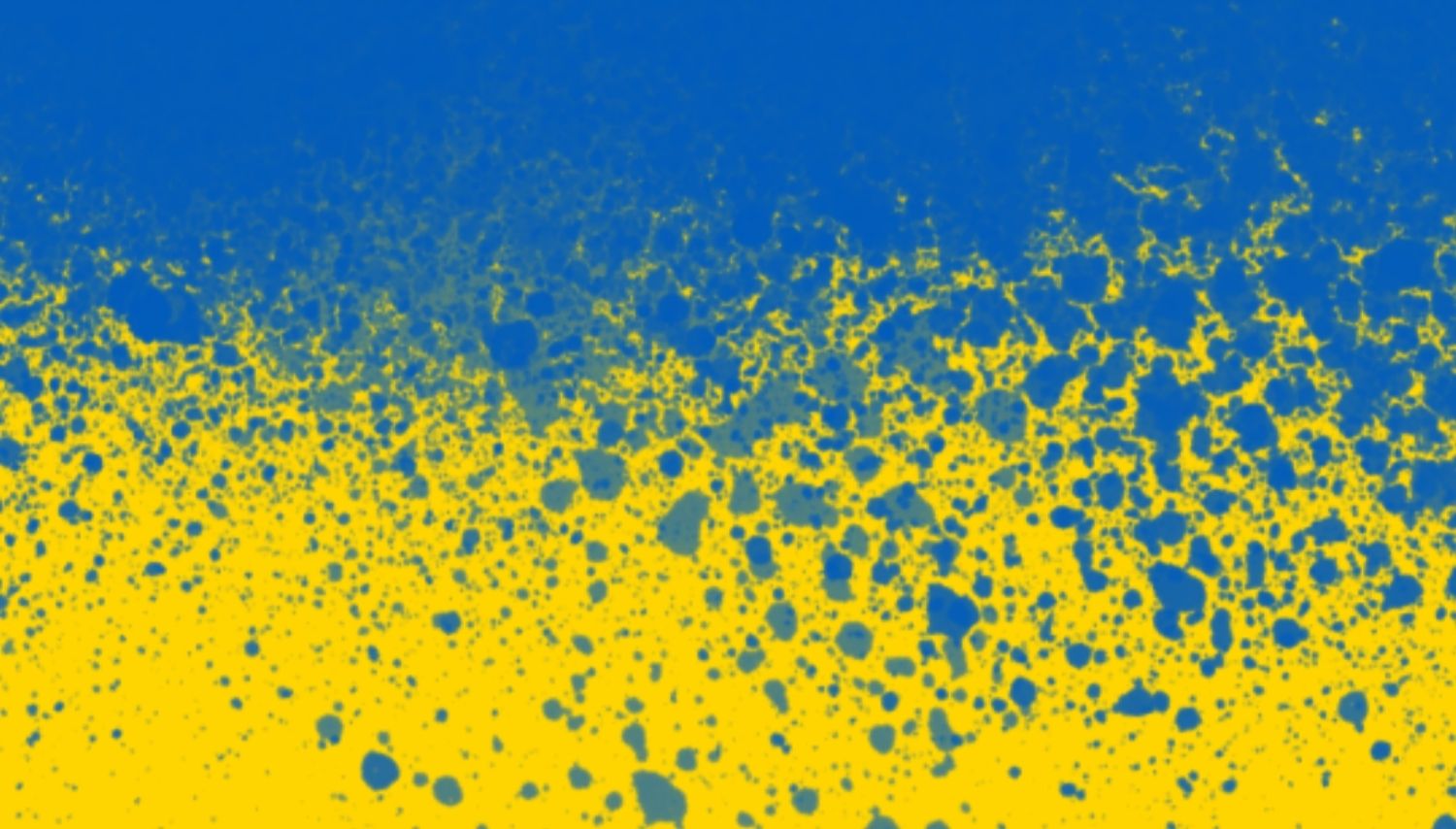Prix de la Paix des libraires allemands 2022 pour Serhiy Jadan – Discours de réception du prix
Prix de la Paix des libraires allemands 2022
Serhiy Jadan
Discours de réception du prix
Un texte qui ne parle pas de la guerre
Ses mains sont noires et usées, le cambouis s’est incrusté dans la peau, s’est figé sous les ongles. Les gens qui ont des mains pareilles, en règle générale, aiment travailler et le font bien. C’est une autre chose de savoir en quoi consiste leur travail. De petite taille, placide, affairé, il explique la situation sur le front, parle de sa brigade, des équipements que lui, chauffeur d’une des unités, est amené à utiliser. Soudain il se décide : vous êtes des bénévoles, n’est-ce pas ? Vous pouvez nous acheter un réfrigérateur ? Tu as besoin d’un frigo au front ? Nous ne comprenons pas. S’il le faut, allons au supermarché, tu choisiras, on achètera. Mais non, explique-t-il, vous ne comprenez pas : j’ai besoin d’un véhicule avec un gros réfrigérateur. Pour transporter les morts. Nous trouvons des corps qui ont passé plus d’un mois au soleil, nous les transportons en minibus, c’est difficilement respirable. Il parle des morts comme de son travail, avec calme et mesure, sans bravade, mais aussi sans hystérie. Nous échangeons nos coordonnées. Une semaine plus tard, nous trouvons un camion frigorifique en Lituanie, nous le convoyons à Kharkiv. Il vient avec ses combattants, en équipe. Ils emportent le véhicule avec les honneurs, font une photo collective pour le rapport. Notre homme est cette fois armé, avec des vêtements propres. Bien que ses mains, à y regarder de plus près, soient tout aussi noires. Son travail est quotidien, pénible, et ce sont ses mains qui en témoignent le mieux.
Qu’est-ce que la guerre change en premier lieu ? La perception du temps, la perception de l’espace. Ils changent très vite, les contours de la perspective, les contours du temps. L’homme dans l’espace de la guerre s’efforce de ne pas bâtir des projets d’avenir, tente de ne pas trop penser à comment sera le monde de demain. Ce qui compte, c’est ce qui t’arrive ici et maintenant ; ce qui a du sens, ce sont les choses et les gens qui resteront avec toi jusqu’au lendemain matin, tout au plus, dans le cas où tu survis et que tu te réveilles. L’objectif principal est de rester entier, d’avancer une demi-journée de plus. Après, plus tard, on verra, on saura comment agir, comment se comporter, sur quoi s’appuyer dans cette vie, quel en sera le nouveau point de départ. Cela vaut principalement pour les militaires, mais aussi pour ceux qui restent en tant que « civils » (autrement dit, non armés), dans la zone de contact avec la mort. C’est précisément ce sentiment qui t’accompagne depuis le premier jour de la grande guerre : la sensation d’une rupture temporelle, l’absence de continuité, le sentiment de compression de l’air, lorsque respirer devient difficile, parce que la réalité pèse, tente de t’expulser de l’autre côté de la vie, de l’autre côté du visible. La compression des événements et des émotions, la dissolution dans un dense flux sanguinolent, qui enveloppe et qui porte : la réalité de la guerre diffère radicalement de la réalité de la paix justement par cette pression, cette impossibilité de respirer en liberté et de parler en légèreté. Et il faut parler. Même en temps de guerre. Surtout en temps de guerre.
La guerre, sans conteste, modifie la langue, son architecture, le champ de son application. La guerre, comme la botte ennemie, viole la fourmilière de la langue. Après quoi, les fourmis, autrement dit, les porteurs de la langue profanée, tentent fébrilement de restaurer la structure détruite, de mettre de l’ordre dans leurs habitudes, dans leur quotidien. D’ailleurs, tout revient et reprend sa place. Mais cette incapacité à utiliser les mécanismes habituels, plus précisément, l’incapacité des constructions précédentes, pacifiques, à transmettre ton état, à expliquer ta colère, ta douleur et ton espoir, est particulièrement atroce et insupportable. Surtout lorsque tu as l’habitude de faire confiance à la langue, de t’appuyer sur ses capacités, qui semblaient presque inépuisables. Et voilà qu’il s’avère que les possibilités de la langue sont limitées. Limitées par de nouvelles circonstances, de nouveaux paysages. Des paysages qui s’inscrivent dans l’espace de la mort, dans l’espace de la catastrophe. Le travail de chaque fourmi consiste à restaurer l’organisation générale de ce langage commun, de cette sonorité commune, de la communication, de la compréhension. Quel est dès lors le rôle de l’écrivain ? Être une fourmi, pétrifiée, comme tout le monde. Depuis le début de la guerre, nous sommes tous en train de restaurer cette capacité blessée : la capacité à s’exprimer intelligiblement. Nous essayons tous d’expliquer ce que nous sommes, notre vérité, les limites de notre blessure et de notre trauma. La littérature, probablement, a un peu plus de chance. Car elle est liée génétiquement à toutes les catastrophes linguistiques et tous les traumas qui ont précédé.
Comment parler de la guerre ? Comment maîtriser les intonations qui recèlent tant de désespoir, de colère, de ressentiment, et en même temps de force et de détermination de ne pas abandonner les siens, de ne pas reculer ? Il me semble que le problème de l’expression de ce qui est le plus important n’est pas seulement en nous. Le monde qui nous écoute est tout aussi incapable de comprendre une chose simple : nous nous exprimons en nous appuyant sur un niveau trop différent d’émotion linguistique, de tension linguistique, d’ouverture linguistique. Les Ukrainiens ne doivent pas se justifier pour leurs émotions, mais il serait bon de les expliquer. Pour quoi faire ? Ne serait-ce que pour ne pas contenir toute cette douleur et toute cette haine. Nous réussirons à nous présenter, nous saurons nous expliquer, parler de tout ce qui nous est arrivé et de ce qui nous attend encore. Il faut juste être prêt au fait que cette conversation ne sera pas facile. Cependant, d’une manière ou d’une autre, il faut la commencer dès aujourd’hui.
Nous entrons dans un moment important pour l’évolution de la charge et de la coloration de notre lexique. Cela pourrait relever de l’optique, d’un autre regard, d’un autre point de vue, mais c’est avant tout une question de langue. Il semble par moment que le monde, en regardant ce qui se passe ces derniers mois dans l’Est de l’Europe, recourt à un lexique et à des définitions qui ont depuis longtemps cessé d’expliquer ce qu’il se passe. Par exemple, que veut dire le monde (je comprends parfaitement le côté éphémère et abstrait de cette notion, mais je vais tout de même y recourir) en parlant de la nécessité de la paix ? On pourrait dire qu’il s’agit de la fin de la guerre, de la cessation de la confrontation armée, du moment où l’artillerie se tait et le silence s’installe. On pourrait croire qu’il s’agit de la chose censée nous réconcilier. Car en réalité, qu’est-ce que nous, les Ukrainiens, souhaitons le plus ? Évidemment, la fin de cette guerre. Évidemment, la paix. Évidemment, la fin des tirs. Personnellement, en tant qu’être humain qui vit au dix-huitième étage en plein centre de Kharkiv, où depuis les fenêtres du haut on peut apercevoir le lancement des missiles russes de la ville voisine de Belgorod, je souhaite ardemment et passionnément la cessation des frappes, la fin de la guerre, le retour à la normalité, à la nature même de l’existence. Alors, qu’est-ce qui met en alerte un Ukrainien dans les déclarations des intellectuels ou des politiciens européens sur la nécessité de la paix ? Bien évidemment, il ne s’agit pas de nier la nécessité de la paix. Il s’agit de la certitude que la paix ne reviendra pas uniquement parce que la victime de l’agression déposera les armes. Les habitants paisibles de Boutcha, de Hostomel et d’Irpin n’avaient pas du tout d’armes. Ce qui ne les a pas protégés d’une mort horrible. Les habitants de Kharkiv, cibles des tirs de roquettes russes, réguliers et chaotiques, n’ont pas d’armes entre leurs mains non plus. Qu’est-ce qu’ils devraient faire d’après les partisans d’une paix rapide à tout prix ? Où devrait passer pour eux la frontière entre un oui à la paix et un non à la résistance ? Tout repose dans le fait, à mon avis, qu’en parlant aujourd’hui de paix, dans le contexte de cette guerre dramatique et sanglante déclenchée par la Russie, certains refusent de comprendre un fait basique : il n’y a pas de paix sans justice. Il existe différentes formes de conflit gelé, il existe des territoires temporairement occupés, il existe des mines à retardement, maquillées en compromis politiques, mais la paix, la paix véritable, celle qui procure la sensation de sécurité et de perspective, malheureusement, est impossible. Et en reprochant aujourd’hui aux Ukrainiens de ne pas vouloir se rendre, présenter cela comme un signe d’esprit va-t-en-guerre et de radicalité, une partie des Européens (je dois préciser, une partie relativement négligeable, et pourtant), adopte une position singulière : en s’efforçant de rester dans la zone de confort, elle quitte allègrement la zone de l’éthique. Et là, il s’agit d’une question adressée non pas aux Ukrainiens, mais au monde, à sa capacité (ou non-capacité) d’accepter une nouvelle injustice, le mal total, incontrôlé, pour complaire à un mercantilisme douteux et à un faux pacifisme.
Car pour certains, il s’agit d’une façon relativement confortable de transférer la responsabilité : en appeler aux personnes qui protègent leur existence, accuser la victime, déplacer les accents, manipuler des slogans gentils et positifs. La réalité est bien plus simple : nous aidons notre armée, non pas parce que nous voulons la guerre, mais justement parce que nous souhaitons ardemment la paix. Seulement, la proposition sous couvert de la paix d’une douce capitulation n’est pas une possibilité de retrouver une vie normale et de reconstruire nos villes. Il est probable que la capitulation des Ukrainiens aiderait les Européens à économiser sur les hydrocarbures, et cependant, comment se sentiraient les Européens en prenant conscience (et il est impossible de ne pas en prendre conscience) que la chaleur de leurs foyers est payée par les destins brisés et les foyers détruits de gens qui, eux aussi, voulaient vivre dans un pays paisible et tranquille ?
Je me répète, c’est une question de langage. De l’usage précis et justifié de tel ou tel mot, de l’exactitude de notre intonation, lorsque nous parlons de l’existence à la limite entre la vie et la mort. À quel point notre vocabulaire d’avant, ce lexique qui hier encore nous permettait parfaitement d’appréhender le monde, à quel point est-il donc opérant aujourd’hui, pour exprimer ce qui nous fait mal ou, au contraire, nous donner de la force ? Car nous nous sommes tous retrouvés dans ce lieu du langage que nous ne connaissions pas auparavant et, par conséquent, notre système de valeurs et de perception est déplacé, le sens a changé de grille de lecture, le besoin a redessiné ses limites. Ce qui de l’extérieur, vu de côté, peut s’apparenter à des conversations sur la mort, en vérité représente très souvent une tentative désespérée de s’accrocher à la vie, à sa possibilité, à sa pérennité. De manière générale, où dans cette réalité nouvelle, brisée et déplacée, se termine le thème de la guerre et où commence la zone de la paix ? Un camion frigorifique avec des corps, c’est encore une question de paix ou déjà une question de guerre ? Les femmes que l’on fait déplacer en lieux sûrs, c’est le soutien de quoi ? D’un règlement pacifique du conflit ? Un garrot militaire acheté pour un soldat, celui qui lui sauve la vie : est-ce encore de l’aide humanitaire ou est-ce déjà une aide militaire ? Et de manière générale, l’aide apportée à ceux qui se battent pour toi, pour les civils dans les caves, les enfants dans le métro : est-ce que cela va au-delà d’une discussion convenable sur le bien et l’empathie ? Devons-nous rappeler notre droit à exister dans ce monde, ou ce droit est-il évident et indiscutable ?
Le fait est que beaucoup de choses, de phénomènes aujourd’hui demandent sinon une explication, au moins un rappel, une nouvelle expression, une nouvelle perception. La guerre montre ce qu’on a longtemps essayé ne pas remarquer. La guerre est le temps des questions gênantes et des réponses difficiles. Cette guerre déclenchée par l’armée russe, a soudain révélé toute une série de questions qui dépassent largement le contexte des relations russo-ukrainiennes. Nous serons amenés, d’une manière ou d’une autre, à discuter dans les années à venir des sujets incommodes : celui du populisme et des standards à géométrie variable, celui de l’irresponsabilité et du conformisme politique, celui de l’éthique qui, comme il s’est avéré, a depuis longtemps et irrémédiablement déserté le vocabulaire de ceux qui prennent les décisions cruciales dans le monde contemporain. On peut dire que ces sujets concernent la politique, que c’est précisément, d’elle, de la politique, que nous devrions parler. Du reste, la politique en l’occurrence n’est qu’un paravent, une couverture, un moyen d’arrondir les angles et de ne pas appeler les choses par leur nom. Alors que c’est justement ce dont elles ont besoin. Que les crimes soient qualifiés de crimes. Que la liberté soit qualifiée de liberté. Que la perfidie soit qualifiée de perfidie. En temps de guerre, ces mots acquièrent une sonorité particulièrement expressive et aiguë. Il est extrêmement difficile de les contourner sans se blesser. D’ailleurs, il ne faut pas les contourner, surtout pas.
C’est triste et révélateur : nous parlons du Prix de la Paix au moment même où l’Europe connaît une nouvelle guerre. Une guerre qui fait rage pas si loin. Et pas seulement depuis quelques mois. Pendant toutes ces années de guerre, le Prix de la Paix a aussi été décerné. Ce n’est pas le Prix en tant que tel qui pose problème, bien évidemment. Le problème est de savoir dans quelle mesure l’Europe aujourd’hui est prête à accepter cette nouvelle réalité, une réalité peuplée de villes détruites (où on pouvait, il n’y a pas si longtemps, faire des affaires), une réalité avec des fosses communes (où gisent des citoyens ukrainiens qui hier encore pouvaient venir dans les villes allemandes pour faire du shopping ou visiter les musées), une réalité où il existe des camps de filtration pour les Ukrainiens qui se sont retrouvés sous occupation (camps, occupation, collaborateurs – voilà des mots qui probablement ne font pas partie du langage quotidien des Européens). Le problème est de savoir comment nous devrons tous vivre dans cette réalité, avec des villes détruites, des écoles incendiées, des livres anéantis. Mais avant tout, avec des milliers de morts, ceux-là même qui hier encore menaient une vie paisible, bâtissaient des projets, vivaient avec leurs soucis et s’appuyaient sur leur propre mémoire.
L’évocation de la mémoire est très importante dans le contexte. Car la guerre n’est pas uniquement une nouvelle expérience. Le dire, c’est parler du superficiel, de ce qui se trouve à la surface, ce qui décrit beaucoup mais explique peu. En réalité, la guerre modifie notre mémoire, l’emplissant de souvenirs trop douloureux, de traumas trop profonds et de conversations trop amères. Tu ne pourras plus te débarrasser de ces souvenirs, tu ne parviendras plus à réparer le passé. Il fera désormais partie de toi. Et probablement pas la meilleure. Ce processus de sidération et de reprise de son souffle, cette expérience de mutisme et de recherche d’une nouvelle langue, est trop douloureux pour qu’on puisse continuer à décrire avec insouciance le monde merveilleux derrière la fenêtre. Après Boutcha et Izioum, la poésie, incontestablement, est possible. Qui plus est, elle est nécessaire. Mais l’ombre de Boutcha et d’Izioum, leur présence auront un trop grand poids dans cette poésie de l’après-guerre, déterminant grandement son contenu et sa tonalité. Cette conscience douloureuse mais nécessaire que désormais, le contexte des poèmes composés dans ton pays seront les fosses communes et les quartiers bombardés, n’ajoute pas de l’optimisme, mais nous fait comprendre que la langue a besoin de nos efforts quotidiens, de notre présence constante, de notre implication. Du reste, qu’avons-nous pour nous exprimer, pour nous expliquer ? Notre langue et notre mémoire.
Depuis la fin du mois de février, autrement dit, depuis le début de ce massacre, on perçoit parfaitement comment le temps a perdu son habituelle mesure, son ondulation. Il est devenu semblable à un cours d’eau hivernal qui gèle de toute sa profondeur, cessant sa course et paralysant tous ceux qui se sont retrouvés au milieu de ce cours figé. Nous nous sommes retrouvés immobilisés au milieu de ce non-temps glacé. Je me souviens parfaitement de cet état désemparé, lorsqu’on ne sent plus le mouvement, lorsqu’on se perd au milieu du silence, incapable de déceler ce qu’il y a juste devant, dans l’obscurité et le silence. Le temps de la guerre est en réalité le temps d’un panorama accidenté, des communications rompues entre le passé et l’avenir, le temps d’une sensation particulièrement aiguë et amère du présent, l’immersion dans l’espace qui entoure, la fixation dans l’instant qui submerge. Il y a en cela certains signes de fatalisme, lorsque tu arrêtes d’échafauder des projets et de songer à l’avenir, tentant avant tout de t’enraciner dans le présent, précisément sous ce ciel qui se déploie au-dessus de ta tête et qui est le seul à te rappeler que le temps passe, que les nuits viennent chasser les jours, qu’après le printemps viendra l’été, immanquablement, et que malgré la paralysie des sentiments, malgré la sidération, la vie continue, qu’elle ne s’arrête pas un instant, contenant toutes nos joies et toutes nos peurs, toute notre détresse et tout notre espoir. C’est juste la distance entre toi et la réalité qui a changé. La réalité est devenue plus proche. La réalité est devenue plus effrayante. Et il faut vivre désormais avec cela.
Que reste-t-il, excepté la langue et la mémoire ? Qu’est-ce qui a changé en nous ? Qu’est-ce qui nous différencie dans n’importe quel rassemblement, dans n’importe quelle foule ? Les yeux, peut-être. Ils absorbent le feu extérieur, ils garderont à tout jamais cette lueur. Le regard d’une personne qui a vu au-delà du visible, qui a scruté l’obscurité et qui a même réussi à y déceler quelque chose, son regard sera toujours différent, car des choses trop importantes s’y reflètent.
Au printemps, vers le mois de mai, nous sommes allés donner un concert à une unité militaire partant au repos après des combats lourds et prolongés. Nous connaissions l’unité depuis longtemps, nous allions régulièrement jouer pour eux depuis 2014. Les environs de Kharkiv, la fraîcheur de la nature, un terrain de foot, une petite salle des fêtes. Nous connaissions personnellement pas mal de combattants. Beaucoup de vieux amis de Kharkiv se sont engagés au printemps. Il était étrange de les voir en uniforme, armes à la main. Et puis ces yeux, inhabituels, comme du métal figé, comme le verre qui reflète l’incendie. Nous étions au deuxième mois de la grande guerre, ils avaient eu le temps de connaître les tranchées sous les tirs russes. Maintenant, ils sourient, ils blaguent. Et leurs yeux, où on peut voir deux mois d’enfer. « J’ai eu le temps, dit l’un d’entre eux, de passer par la case hôpital. Les Russes tiraient avec des munitions au phosphore, j’ai été touché. Mais tout va bien, je suis en vie et en bonne santé. Je retourne bientôt au front. » Ce genre de situation où tu ne sais pas quoi répondre : la langue fait défaut, les mots nécessaires restent à trouver. Mais ils viendront, sans faute.
Comment sera notre langue après la guerre ? Qu’est-ce que nous aurons à nous expliquer les uns aux autres ? Avant toute chose, il nous faudra prononcer à haute voix les noms de ceux qui sont tombés. Ils doivent être nommés. Sinon, la langue sera trop lacunaire, il y aura du vide entre les voix, une rupture de la mémoire. Il nous faudra beaucoup de force et de foi, pour parler de nos morts. Car c’est leurs noms qui vont former nos dictionnaires. Mais il nous faudra non moins de force, de certitude et d’amour pour parler de l’avenir, pour le rendre audible, le verbaliser, le circonscrire. Nous devrons d’une manière ou d’une autre rétablir la sensation du temps, de la perspective, de la continuité. Nous sommes condamnés à avoir un avenir. Bien plus, nous en sommes responsables. Il se dessine aujourd’hui à partir de nos visions, de nos convictions, de notre capacité à prendre nos responsabilités. Nous ferons revenir la sensation de notre avenir, car beaucoup de choses dans notre mémoire demanderont notre implication demain. Nous sommes tous liés dans cette déferlante qui nous porte, ne nous lâche pas, nous unit. Nous sommes tous reliés par notre langue. Et même si par moment ses chances nous semblent limitées ou insuffisantes, nous serons d’une manière ou d’une autre amenés à revenir à ses possibilités, qui nous donnent l’espoir que dans le futur, il n’y aura pas de non-dits et d’incompréhension entre nous. La langue peut parfois paraître faible. Et pourtant c’est elle qui est souvent la source de la force. Elle peut te lâcher un certain temps, mais elle est incapable de trahir. Et c’est essentiel et déterminant. Tant que nous avons notre langue, nous avons des chances, quand bien même fussent-elles éphémères, d’expliquer qui nous sommes, de dire notre vérité, de faire le ménage dans notre mémoire. Dès lors, parlons, ne nous arrêtons pas. Même lorsque nos mots écorchent la gorge. Même si nous nous sentons perdus et vides en parlant. Derrière la voix se tient la possibilité de la vérité. Et cela vaut la peine d’en profiter. C’est sans doute là ce qui peut nous arriver de plus important.
Francfort, le 23 octobre 2022
Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn
Serhiy Jadan, écrivain ukrainien, vient de publier son nouveau roman L’Internat aux Éditions Noir sur Blanc, dans une traduction d’Iryna Dmytrychyn.